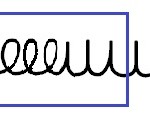La taille du lignage
Mi-août, c’est déjà l’approche de la rentrée. Une question revient encore et toujours : celle du choix du lignage. Ai-je bien fait de prendre du Seyes 4 mm ? N’aurait-il pas mieux valu prendre du 3 ? ou du 5 ?
Cette question traduit surtout l’angoisse de l’incertitude, comme on le perçoit dans le message ci-dessous.
Bonjour Madame Dumont.
J’aurais besoin d’un de vos précieux conseils. Jusqu’à présent, en CP, j’avais tendance à démarrer l’année avec des seyes 4mm… Or, depuis quelques temps, j’ai la sensation que pour de nombreux élèves, cette réglure est en fait trop grosse (quant à ceux pour lesquels elle ne semble pas l’être, c’est essentiellement parce que leur difficulté semble ailleurs: je parle là des élèves qui ne se posent pas sur la ligne par exemple)… mais c’est juste une sensation. Vous avez sans doute beaucoup plus de recul que moi sur la question, du coup, je me permets de vous demander conseil.
J’en profite pour vous dire que votre ouvrage a métamorphosé ma façon d’enseigner l’écriture et, qui plus est, qu’il m’a offert l’occasion d’apprendre à aimer celui-ci… donc: MERCI!
Cordialement,
Emmanuelle
La question porte sur le choix du lignage. En apparence. L’incertitude, plus ou moins inconsciente, sur la réalité de la problématique s’exprime dans l’expression « j’ai la sensation« , reprise pour confirmation « c’est juste une sensation« . En analysant la question on se rend compte qu’Emmanuelle nous dit « et si ce n’était pas un problème de lignage ? »
Voila qui nous fait poser un regard différent sur la problématique : la question de quelle dimension faut-il que soit le lignage ? en cache une autre : que faut-il faire pour que l’enfant puisse écrire dans le lignage ? On perçoit alors que la réponse ne réside pas seulement ( voire pas du tout…) dans le choix du lignage mais dans l’enseignement de l’art de bouger ses doigts pour écrire dans le lignage.
L’art de bouger ses doigts pour écrire se prépare le plus tôt possible. Il donne accès à une écriture fluide et sans effort (mais ce rapprochement relève du pléonasme). Les doigts ne peuvent bouger vivement et souplement que s’ils sont libres. Cela implique nécessairement un bon appui des organes scripteurs sur la feuille.
Un appui adapté s’obtient lorsque la main, le poignet et l’avant-bras sont posés sur la feuille. Si ce n’est pas le cas, l’enfant va se fatiguer à soulever le poignet et appuyer trop fort sur la mine du crayon (les deux vont de pair).
En même temps que ou après l’apprentissage d’un bon appui, l’enfant apprendra à bouger ses doigts. Pour cela le yoyo, la course aux zigzags ont fait leurs preuves depuis plus de 20 ans. Les coloriages verticaux ou en rond de petites zones également (on les trouve entre autres dans J’apprends à bien tenir mon crayon – Collection Le petit plus, chez Belin.) Plus ludiques, les jeux de bouchons (cousins des jeux de billes) sont l’idéal pour l’été car ils se pratiquent sans crayon ni papier et n’évoquent pas l’écriture ni même l’école.
Une fois que l’enfant sait placer sa main et manier son crayon, alors il est prêt à écrire sans difficulté dans du lignage de toute dimension.
Les lignage trop grands sont toutefois à éviter pour les petites mains non encore expertes.
Donc, avant que se pose la question du lignage, il faudra donc :
1 – apprendre à l’enfant à poser le poignet sur la table
2 – éviter tout exercice qui, en position assise, fera tenir le coude en l’air (sauf faire des fonds de peinture au rouleau en déplaçant le bras horizontalement).
3 – faire faire des exercices de mouvement des doigts poignet et avant-bras en appui sur le support.
(4 – faire des exercices de gestion statique de l’espace graphique)
Les près de 40 pages du chapitre 13 de la nouvelle édition du Geste d’écriture (édition 2016) sont consacrées à la question de la tenue et du maniement du crayon. Les exercices y sont abondamment illustrés pour une bonne compréhension.